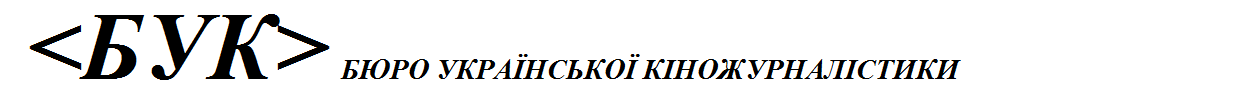Fabien Deglise, Le Devoir про книгу Sébastien Ste-Croix Dubé «La culture du divertissement. Art populaire ou vortex cérébral?» присвячену культурі розваг та новій ролі екранних мистецтв і телевізійних серіалів.
«La fin du XXe siècle correspond à une ère où le besoin de se détendre ne se fonde plus sur les questions d’effort et de récompense, mais est une condition inhérente à une journée bien accomplie», affirme Sébastien Ste-Croix Dubé.
Ce n’est pas parce que c’est divertissant qu’il ne faut pas apprendre à s’en méfier. En 1932, dans Le meilleur des mondes, Aldous Huxley imaginait une société tellement obsédée par le besoin de plaisir et de divertissement qu’elle en finissait par faire perdre toute forme de liberté à ses citoyens. Une dystopie lointaine ? Une réalité que le présent serait plutôt en train de métaboliser, estime le jeune essayiste Sébastien Ste-Croix Dubé dans La culture du divertissement: art populaire ou vortex cérébral ? (Varia), analyse en règle du rapport tordu que nous entretenons avec nos écrans.
« L’hyperdivertissement est la façon que nous avons trouvée pour affronter la complexité du monde tout en restant dans un environnement agréable, explique-t-il, assis à la terrasse d’un café montréalais où Le Devoir l’a rencontré au début de l’été. Or, la dictature de l’écran, loin de nous libérer, nous isole, nous éloigne du réel, nous enferme dans un principe économique qui tient du nouvel esclavage, qui nous place face à un voile anesthésiant », voile derrière lequel nos asservissements personnels, collectifs, tout comme les dérives totalitaires du monde qui nous entourent n’arrivent même plus à être visibles.
L’avènement de la télévision dans les années 50 a donné le la. La numérisation des contenus et la miniaturisation des outils de diffusion ont fait le reste. En moyenne, en Amérique, un citoyen passe quotidiennement plus de 11 heures le nez sur un écran en compagnie d’un média électronique, fait remarquer M. Dubé en introduction de son livre.
La multiplication des formats courts, les vidéos qui alimentent des fils contenus de diffusion en ligne, la socialisation en ligne qui repose principalement sur le partage d’informations superficielles y sont pour beaucoup. Tout comme d’ailleurs la mise en série d’oeuvres télévisuelles qui, même avec des épisodes à la qualité et à la pertinence variables, arrivent à tenir occupés les humains en mal d’évasion sur une longue période de temps, dans un engagement et une passivité qui ne se calculent plus en heure, mais en saisons, en frénésie d’absorption, le fameux binge watching, comme on dit à Toronto, de chapitres consécutifs.
« L’offre dépasse nettement le besoin et, plus encore, la demande. Ce système qui date des années 80 est nommé “politique économique de l’offre”, ou mieux Reaganomics en l’honneur de son instigateur principal, Ronald Reagan », écrit l’essayiste qui a commencé à plancher sur son sujet dans l’espoir d’en faire une thèse de doctorat, mais qui a bifurqué en chemin sur la route de l’essai, son premier ici, afin d’amener sa réflexion plus près du citoyen connecté et des victimes de la culture du divertissement.
Condition inhérente
« Aucune instance ne gouverne notre besoin de consommer 11 heures de divertissement par jour. Aucune institution ne régule notre désir frénétique de regarder la quatrième saison de Game of Thrones, rognant ainsi sur nos heures de sommeil. Ni de faire le tour une énième fois du jeu The Last of Us. […] La fin du XXe siècle correspond à une ère où le besoin de se détendre ne se fonde plus sur les questions d’effort et de récompense, mais est une condition inhérente à une journée bien accomplie », ajoute-t-il.
Pour l’essayiste, le problème n’est, bien sûr, pas dans le divertissement, chose « nécessaire à la survie de l’espèce », dit-il, mais bien dans le dosage. Les volumes démesurés qui donnent corps au divertissement des temps présents sont autant la responsabilité de celui ou celle qui regarde l’écran de son téléphone dit intelligent près de 200 fois par jour, en moyenne, que des industries culturelles qui maîtrisent de mieux en mieux l’art de produire des contenus dont le caractère essentiel reçoit l’assentiment des masses et même, de plus en plus, des intellectuels, pourtant les gardiens d’une certaine lucidité, admet-il.
Or, « toute forme de divertissement passif qui nous détourne d’une occupation active et constructive, lorsqu’elle est consommée en trop grande quantité, nous fait du tort », écrit-il. Elle fait naître angoisse et anxiété qui, dans un paradoxe savoureux, trouvent leur remède temporaire dans la consommation de produits culturels. Elle éloigne aussi du réel « produisant à son tour une anxiété sournoise terrible ».
« La culture du divertissement nous pousse précisément à oublier le merdier qui s’étend autour de nous et autour du monde entier », dit M. Dubé, qui ne peut s’empêcher de voir dans la mécanique en place la réalisation des prophétiques récits de science-fiction d’un autre temps. « Le lavage de cerveau totalitaire n’a même plus besoin d’être opéré de l’extérieur à coup de propagande, il a assez bien été intériorisé pour qu’il suffise de le renforcer par ce qu’on appelle le glam et par la publicité. »
Il se demande aussi si « le divertissement de masse n’est pas le moyen politique le plus efficace qui soit pour empêcher d’ébranler les pouvoirs politiques en place » et appelle au passage et au fil des pages à combattre non pas les écrans, ni le divertissement, mais bien « l’oisiveté que les deux peuvent générer ensemble ».
« C’est par l’action que l’on peut s’en sortir, par la résistance à la dictature du divertissement à outrance, par la résistance aux algorithmes qui font du divertissement une boucle sans fin » et par la prise de conscience qu’à grande dose, la série télé, les vidéos consommées par fragments, le partage de drôleries, d’insolite, de divertissement qui contaminent tout, y compris le monde de l’information, ne peuvent que détruire le tissu social, anéantir l’équilibre psychosocial d’une communauté et des individus, tout en promettant, comme dans la fiction d’Huxley, ce monde meilleur… que la passivité ne peut certainement pas permettre d’atteindre.
« On évalue difficilement le nombre de selfies annuels; plusieurs statistiques estiment qu’il tourne autour de 40 milliards. Le selfie est l’expression du désir de se fictionnaliser, de se projeter dans l’Olympe. Ce qui me fascine avec l’égoportrait, cette forme de narcissisme libéré, c’est qu’il est censé capter quelque chose sur le vif, alors qu’en fait, il est une mise en scène spectaculaire de notre quotidien. De 18 % à 35 % des égoportraits publiés sur Instagram (l’application la plus utilisée au monde pour le selfie) sont pris à l’aide d’un filtre ou carrément modifiés. »
« Pourquoi ? Parce que la culture du divertissement nous a conditionnés au spectacle, à la mise en scène, poursuit M. Dubé. Certains adeptes de l’égoportrait repoussent leurs limites en prenant une photo d’eux-mêmes dans une situation ou un lieu extrême. Les exemples les plus récurrents sont vertigineusement liés aux cliffhangers (en équilibre sur un gratte-ciel, couché sur le bord d’une falaise, par la fenêtre d’un avion, etc.). Aussi, parmi les plus populaires, il y a ceux pris aux côtés d’animaux sauvages (une baignade avec des requins, fumer une cigarette avec trois cobras, manger un sandwich en compagnie de deux tigres, etc.). Ou bien encore tout ce qui est lié aux armes (prendre son bain avec une grenade, faire du yoga avec un lance-roquettes, etc.). Bien entendu, le taux de mortalité dû aux selfies est en pleine croissance. »
La culture du divertissement. Art populaire ou vortex cérébral?
Sébastien Ste-Croix Dubé, Varia, Montréal, 2018, 190 pages
Photo: Catherine Legault, Le Devoir
Fabien Deglise, Le Devoir, 21 серпня 2018 року