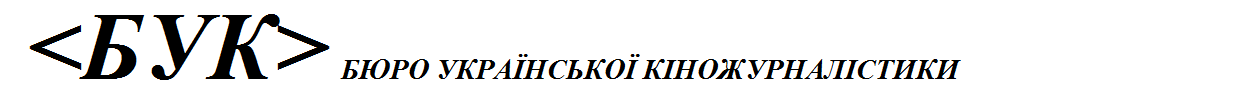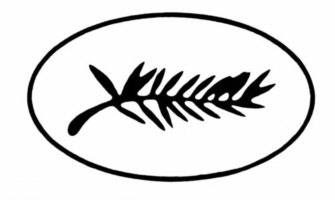
Подаємо тексти з експозиції Французької синематеки, присвячені буремним сторінкам Каннського МКФ – найбільшим скандалам, які струшували фестиваль.
Scandales cannois
Huées, doigts d’honneur et poings levés… Cannes ne serait pas Cannes sans ses sifflets, ses batailles d’Hernani, ses palmarès contestés et ses jurys déchirés. Passage en revue détaillé de 26 controverses qui ont émaillé l’histoire du festival.
29 avril 1956
Nuit et brouillard
Décembre 1955 : le film d’Alain Resnais Nuit et brouillard est présenté à la commission de contrôle. Celle-ci exige la suppression d’un plan de trois secondes. Objet du délit ? Le képi d’un gendarme français surveillant le camp d’internement de Pithiviers en 1941. D’un coup de gouache noire, le cinéaste fait disparaître de la photo le couvre-chef de la honte. Il reçoit le prix Jean-Vigo le mois suivant. Dix ans après la fin de la guerre, Nuit et brouillard devient un document incontournable pour saisir le degré de compréhension du système concentrationnaire hitlérien. Mais avec sa sélection au Festival de Cannes, une nouvelle affaire éclate.
Avril 1956 : le film d’Alain Resnais disparaît curieusement de la liste officielle des films en compétition, remplacé par Tant qu’il y aura des bêtes de Brassaï. On lui reproche ses plans de corps et de cadavres, jugés trop choquants, « incompatibles » avec l’atmosphère de fête cannoise. Qui plus est, il s’agit de ne pas gâcher les relations franco-allemandes, l’ambassade de RFA craignant que le documentaire, consacré aux camps de la mort, ne ravive la haine contre le peuple allemand.
Familles et associations de déportés s’indignent et menacent de défiler sur la Croisette en tenue rayée. C’en est trop. Jean Cayrol, auteur du texte du film, fait éclater sa colère en publiant une tribune sanglante dans Le Monde : « En arrachant brusquement de l’Histoire les pages qui ne lui plaisent plus, La France refuse d’être la France de la vérité », celle de reconnaître ses responsabilités en matière de déportation. Face à la pression, le film est finalement programmé à Cannes, mais hors compétition, le 29 avril, jour de commémoration nationale des déportés.
Soutenu par le Parti social-démocrate allemand, Nuit et brouillard est présenté la même année au Festival de Berlin. Dans la salle, le critique Jean de Baroncelli voit le film pour la troisième fois. « Jamais le silence, le recueillement de la foule, ne m’a paru aussi impressionnant qu’à Berlin. »
11 mai 1960
La Dolce vita
« Précédé de clameur, de scandale et de polémiques violentes, un film sensationnel était arrivé au pays. Le curé de San Firmino avait déchaîné ses foudres contre ce film licencieux et ordonné aux fidèles de le boycotter. Sans grand résultat. “Des orgies dignes de Tibère !” “On échange ses femmes !” “Strip-tease !” “Allons-y, les gars !” »
La scène se passe dans Divorce à l’italienne de Pietro Germi, tourné en 1961. La voix off est celle de Marcello Mastroianni. Le film dont tout le monde parle : La Dolce vita. Le clin d’œil résume parfaitement l’agitation que provoqua l’œuvre de Fellini à sa sortie, un an auparavant.
Tout commence à Milan en février 1960. La première projection de La Dolce vita déclenche un tapage sans précédent dans l’histoire du cinéma. Le public est indigné par les déambulations de Marcello, journaliste mondain, balancé entre jouissance et désillusions, et le fait savoir. Pendant la soirée de gala, un spectateur crache sur Fellini, un autre crie à Mastroianni qu’il est « un fainéant ! Un débauché ! Un communiste ! » Qualifié de « moralement inacceptable », le film devient dès lors la cible des autorités religieuses. Certaines scènes sont jugées blasphématoires et le pape lui-même voudrait condamner Anita Ekberg pour port illégal de la soutane. Le Vatican menace d’excommunication tout chrétien qui irait se rincer l’œil. Le lendemain, craignant que la censure n’intervienne pour de bon, une foule en délire brise les vitrines d’un cinéma et se rue pour admirer les courbes délictueuses de l’actrice suédoise, ruisselante dans sa robe à fourreau noir.
Lorsque La Dolce vita est présenté trois mois plus tard au Festival de Cannes, c’est déjà un véritable phénomène de société et un énorme succès commercial. Là encore, le film déchaîne les passions. On crie au génie ou au scandale. Le public de la Croisette « siffle ce film qui le met en peinture. Snobs, starlettes, filles de partouzes, journalistes survoltés, tous ont ressenti cette gifle et hurlé en se frottant la joue. » S’ensuivent une orgie romaine pour tout ce beau monde dans une villa cannoise, avec paparazzi et magnums de champagne au fond de la piscine, puis une Palme d’or pour La Dolce vita, consacrant Fellini, metteur en scène superstar.
15 mai 1960
L’Avventura
15 mai 1960, date de la bataille d’Hernani du cinéma moderne. La projection de L’Avventura au Festival de Cannes marque une rupture avec les codes esthétiques classiques du cinéma et ce n’est pas du goût de tout le monde. Déconcerté par les longs plans-séquences en noir et blanc d’Antonioni, le public baille, siffle, ricane. C’est un désastre. Antonioni descend les marches du Palais dans un silence de mort. Monica Vitti pleure. C’est son premier film, son premier festival. Bagarres entre les spectateurs divisés. Les uns trouvent le film maniéré, interminable, insupportable et même pornographique. Les autres fustigent l’hostilité ambiante et s’emportent contre « ces imbéciles pour qui le cinéma tient de la foire et du bas commerce ». « L’amour vous fait rire ? Vous êtes futiles. »
Mais la bronca ne s’arrête pas là. Le soir-même de la projection, un incident éclate au dîner de gala donné au Palm Beach par la production du film. Dario Moreno, venu pousser la chansonnette, est violemment interrompu par Alain Cuny, outré de voir l’interprète de Si tu vas à Rio amuser la galerie après tous les déshonneurs faits au film d’Antonioni. Cuny lance au chanteur : « Vous n’êtes qu’un pitre, vous n’êtes qu’un poisson énorme et visqueux, comme celui qu’on voit à la fin de La Dolce Vita ! » Moreno lui répond avec classe : « Monsieur, je regrette vos paroles parce que moi, je vous admire beaucoup. » Le scandale éclate. Alain Cuny est immédiatement exclu du festival par le délégué général Robert Favre Le Bret.
Le lendemain, à l’hôtel, on apporte une lettre à Antonioni. Une longue liste de noms, Roberto Rossellini en tête, un message de soutien et d’admiration précédé de ces quelques mots : « Hier soir, nous avons vu le plus beau film jamais projeté dans un festival. » L’Avventura recevra le Prix du jury.
« On m’a fait, racontera Antonioni, un procès pour un baiser que Ferzetti donnait sur le cou de Monica Vitti. J’ai dû couper 7 mètres. Des années plus tard, on me convoque au poste de police et un fonctionnaire me dit : “Je dois vous remettre le corps.” “Le corps ?”, murmurai-je d’une voix faible en pensant tout de suite à un malheur. “Le corps du délit”, continua le fonctionnaire. C’était les 7 mètres du négatif que j’avais dû couper. »
17 mai 1961
Viridiana
L’affaire commence lorsque Luis Buñuel accepte de revenir tourner en Espagne malgré son opposition au régime franquiste qui l’avait conduit à s’exiler au Mexique. L’histoire de son nouveau film : Viridiana, une jeune religieuse prête à prononcer ses vœux, rend une dernière visite à son oncle. Obsédé par le souvenir de sa femme morte le jour de leurs noces, le vieil homme se met à fantasmer sur sa nièce. Il veut l’épouser, elle refuse. Il songe à la violer, change d’avis, se pend avec une corde à sauter. Elle hérite du château et décide d’y recueillir un groupe de mendiants.
Le montage à peine terminé, Buñuel est invité au Festival de Cannes. Il propose de s’y rendre avec une copie de Viridiana dont on programme la projection, in extremis, la veille de la soirée de clôture. Coup de théâtre ! Le jury de Jean Giono lui décerne la Palme d’or, partagée avec Une aussi longue absence d’Henri Colpi. En l’absence du cinéaste, le directeur de la cinématographie espagnole, José Muñoz Fontán, rayonnant, monte sur scène récupérer le trophée.
Mais la joie du haut fonctionnaire retombe bien vite. Deux jours plus tard, le Vatican crie au blasphème. C’est le scandale ! Franco en personne limoge le pauvre Muñoz Fontán. Des mesures sont prises sur-le-champ : le permis de tournage de Viridiana est annulé rétroactivement. Le film est censuré en Espagne. Sa sortie retardée en France. Les journaux ont pour interdiction d’en parler. À Rome, le procureur général attaque Buñuel en justice et le condamne à la prison s’il se rend en Italie.
Comment une œuvre aussi impie a-t-elle pu obtenir le visa de censure ? Couteau en forme de crucifix, couronne d’épines jetée au feu, scène d’amour sur fond de Requiem de Mozart, l’Alléluia du Messie de Haendel pendant une odieuse orgie. Et surtout cette reconstitution de la Cène de Léonard de Vinci pour le banquet des mendiants avec, en lieu et place du Christ, un affreux clochard ivre et aveugle.
Pourtant, Buñuel reçoit bien, au départ, l’autorisation de tourner, la censure n’exigeant qu’une seule modification à la toute fin du film : Viridiana se rend dans la chambre de son cousin, insinuant une liaison incestueuse. Don Luis le rusé accepte de remplacer la scène : la jeune femme rejoint finalement le cousin et la servante en pleine partie de belote rendant la fin du film… plus immorale encore, puisqu’elle suggère un futur ménage à trois !
16 mai 1973
La Maman et la putain
1973, très bon millésime à scandales. A l’instar de La Grande bouffe, plus gros score au scandalomètre présenté à Cannes la même année, le premier long métrage de Jean Eustache en fait blêmir plus d’un. Ingrid Bergman, présidente du jury, ne cache pas son aversion et regrette que « la France ait cru bon de se faire représenter par ces deux films, les plus sordides et les plus vulgaires du festival ». L’actrice n’y peut rien, son jury honore La Maman et la putain de son Grand prix spécial.
Qu’il fascine, choque ou ennuie, le film d’Eustache divise et ne laisse pas indifférent. Témoignage désenchanté de l’après-68, d’une durée exceptionnelle de 3h30, La Maman et la putain heurte les bonnes âmes par ses dialogues crus et provocants : « J’adore baiser avec les métèques », « Essayez de m’enlever ce tampax ». Le récit des états d’âme sentimentaux d’Alexandre (Jean-Pierre Léaud) glisse le spectateur au cœur d’un triangle amoureux qui dérange. Mais plus encore, c’est la mise en scène d’Eustache qui agace. Plans fixes interminables, mouvements de caméra inexistants. Trop statique, mais aussi trop bavard, le film, sans intrigue, est une succession de conversations et de monologues que certains voient comme « un monument d’ennui et un Himalaya de prétention ». On n’aime ni le style ni le jeu de Léaud qui « joue faux ».
En filigrane, la vie et les tourments affectifs d’Eustache lui-même, qui fait rejouer aux acteurs ses propres disputes et confidences. Au lendemain d’une projection privée du film, Catherine Garnier, ex-compagne et costumière du cinéaste (qui prêta son appartement pour le tournage), met fin à ses jours en laissant ce mot : « le film est sublime, laissez-le comme il est. » Jean Eustache se suicidera huit ans plus tard à l’âge de 42 ans.
21 mai 1973
La Grande bouffe
Pâtés de foie, poulettes de Bresse, cuissots de chevreuil, sein en gélatine et tarte aux fesses. Non, en cette soirée du 21 mai 1973, le public cannois n’apprécie pas du tout le menu de Marco Ferreri. Bien que préparé par Fauchon, le banquet sent fichtrement le vomi, la merde et le sexe. La chère et la chair se rejoignent dans un excès de sueurs, vertiges et hurlements. C’est le malaise. « Vous n’avez plus qu’à nous pisser dessus maintenant ! », lance un spectateur pendant la projection.
Sur l’écran, Tognazzi, Mastroianni, Piccoli et Noiret, accompagnés de l’ange Ferréol aux formes généreuses, s’adonnent aux bacchanales de Ferreri, se goinfrant jusqu’à en crever. Le cinéaste italien, avec l’aide de Rafael Azcona, scénariste de Buñuel, livre une œuvre violente, impudique et scatologique qui, dans la France de Pompidou, « dépasse tout ce qu’un être normalement constitué doit pouvoir supporter ». Sur la descente des marches, c’est la cohue. Les acteurs se font bousculer, insulter. « C’est immonde ! Une ignominie ! Vous êtes de honteux pornographes ! » Sélectionné pour représenter la France au Festival de Cannes, La Grande bouffe fait rougir de honte une grande partie des Français.
La presse joue les rapporteurs : « Beurk ! a éructé Charles Vanel. Lelouch et Marthe Keller étaient à deux doigts de la nausée. Montand est parti une demi-heure avant la fin avec son camarade César. » Envoyé spécial pour Europe 1, François Chalais suffoque : « Le Festival a connu sa journée la plus dégradante et la France sa plus sinistre humiliation. On se demande comment monsieur Philippe Sarde, après la délicate musique de César et Rosalie, a accepté qu’on chie et qu’on pète sur sa musique. »
Mais quelle meilleure publicité qu’un tel scandale ? Le sulfureux producteur de La Grande bouffe, Jean-Pierre Rassam, en profite pour faire monter la sauce et déclare que « les gens de cinéma sont tous des cons ». Les semaines suivantes, dans le plus grand calme, le public se rend en nombre voir le film. Déjà culte.
29 mai 1978
L’Homme de marbre
1978. Cachées dans un appartement tenu secret, les bobines portent un faux titre : J’irai cracher sur vos tombes. Gilles Jacob, le patron du festival, les a fait sortir de Pologne en catimini. Interdite par les autorités polonaises pendant deux ans, l’œuvre est à présent bloquée à l’exportation. Pour déjouer la censure, L’Homme de marbre d’Andrzej Wajda devient le secret le mieux gardé de la Croisette.
C’est là que naît l’idée du « film surprise ». Celui dont tout le monde parle, jusqu’au lever de rideau, veille de la clôture. Impatiente de découvrir l’objet de tant de mystères, toute la profession écoute les confidences rocambolesques du délégué général et son vœu d’« aider les films interdits à naître ». Avec ce portrait d’un maçon stakhanoviste des années 50, « héros du travail » dont on affichait le portrait comme exemple à l’entrée des usines, le cinéaste polonais jette un regard critique sur les pratiques administratives autoritaires de son pays.
En pleine guerre froide, L’Homme de marbre fait l’effet d’une bombe et sa projection à Cannes est vue comme un événement historique. Gilles Jacob en est fier : « Pour la première fois, un film européen a été analysé à la rubrique politique dans le New York Times. » Cinématographiquement, le film est considéré comme l’un des meilleurs de Wajda et aurait bien pu voler la Palme à L’Arbre aux sabots d’Olmi.
Trois ans plus tard, Wajda sort une suite à son Homme de marbre. L’Homme de fer est lui aussi présenté au festival en tant que « film surprise ». Mais cette fois le maître polonais est à Cannes pour recevoir la Palme d’or.
22 mai 1978
La Petite
« Louis Malle, encore un scandale ! » Après Les Amants en 1958, Le Feu Follet en 1963, Le Souffle au cœur en 1971 et Lacombe Lucien en 1974, Louis Malle défraie une fois de plus la chronique avec son premier film américain, La Petite, présenté en sélection officielle du Festival de Cannes en 1978. Objet du délit ? L’histoire, au début du XXe siècle, d’une gamine de douze ans élevée dans un bordel de La Nouvelle-Orléans, où sa mère est pensionnaire. La jeune Brooke Shields, du même âge que son personnage, interprète l’adorable Violet, virevoltant entre les chambres et le salon capiteux, traînant dans les jambes de ces dames et de leurs messieurs.
Une partie du public cannois crie à la provocation. Mais c’est surtout une scène qui crée le malaise : celle qui décrit la vente aux enchères de la virginité de l’enfant. Louis Malle se défend. « Rien de scandaleux dans le fait de raconter une histoire vraie. La prostitution enfantine existe, elle a toujours existé. Il y a des articles dans les journaux à ce sujet, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas en faire un film. » Les journalistes cherchent alors la faille du côté de Brooke Shields. N’a t-elle pas été choquée lorsque Malle lui a proposé un rôle aussi sulfureux ? Seulement, la jeune actrice n’en est pas à son premier scandale. À l’âge de dix ans, elle pose, sortant du bain, nue et maquillée. Plus tard, la photo de Gary Gross est interdite en raison de « son potentiel de provocation sexuelle ». Le scandale glisse sur la Lolita. À Cannes, avec le film de Louis Malle, la petite Brooke devient une star de douze ans.
17 mai 1980
Que le spectacle commence
1980. Le Festival de Cannes ne commence pas sous les meilleurs auspices. Une erreur typo dans un télégramme envoyé à Hollywood vaut à Kirk Douglas d’être nommé Président du jury, alors que l’invitation était en fait destinée à… Douglas Sirk. Une incroyable maladresse, comme le signe précurseur d’une quinzaine au climat délétère, toute en malentendus et quiproquos.
C’est pourtant une sélection haut de gamme que le jury est amené à juger cette année-là : Pialat, Resnais, Scola, Hopper, Bellocchio, Fuller, Ashby, Kurosawa, Fosse ou encore Tarkovski sont en lice pour la Palme. Mais rien ne se passe comme prévu. Une météo cafardeuse plombe l’ambiance d’entrée, douchant l’enthousiasme général. Dirk Bogarde, membre du jury, dans une lettre à une amie journaliste : « Mon Cannes, sinistre, s’est terminé avant-hier sous une pluie torrentielle qui n’a pas discontinué pendant 15 jours. Films embués, jury embué, esprits embués… ». L’atmosphère au sein du jury est à l’avenant : fraîche. Au fil des jours et de la sélection se dessinent deux clans, les pro-Kurosawa et les pro-Fosse. Le courant ne passe pas, les jurés ne se comprennent pas – au propre comme au figuré – jusqu’à une délibération que l’on dit extrêmement houleuse. La légende cannoise veut que Kirk Douglas ait convaincu les jurés de couronner Kagemusha d’Akira Kurosawa, puis ait pris congé de ses collègues. Profitant de son absence, une partie du jury aurait alors tenté, et réussi, un coup de force et fait rajouter in extremis Que le spectacle commence de Bob Fosse en lauréat ex æquo. Pour couronner le tout, on soupçonne les huiles cannoises d’avoir inventé un Grand prix spécial du jury sur mesure, afin de récompenser Mon Oncle d’Amérique du Français Alain Resnais.
Quand il monte sur scène pour la remise des prix, Kirk Douglas fulmine. Ce palmarès tiède n’est pas le sien. La cérémonie avance, morose, avec Michel Drucker en Monsieur Loyal. Vient l’annonce des deux lauréats. Akira Kurosawa récupère son prix sous des tonnerres d’applaudissements. Bob Fosse, appelé sur scène, n’est pas là pour recevoir le sien. Le public se perd en conjectures : Fosse, vexé par sa demi-Palme, s’est-il fait porter pâle ? Ou le revirement de dernière minute du jury l’a-t-il empêché de revenir à temps ? C’est son producteur, René Donzelot, qui le remplace et lit un télégramme de remerciements sous les sifflets de la salle. Alors qu’il demande à ce qu’on lance un extrait des deux films pour clore la soirée, Drucker est brutalement interrompu par Kirk Douglas, en français dans le texte : « Je voulais juste ajouter que, pour un grand prix comme ça, un télégramme, ce n’est pas assez. On doit être ici, et l’accepter. » Dans ses mains, la Palme d’or, qu’il a sèchement reprise des mains du producteur.
À ses côtés, Bogarde, hagard, hilare, on ne sait plus trop… L’acteur écrira, deux jours plus tard, toujours dans sa lettre : « Le soir de la cérémonie, j’ai été appelé pour remettre la Palme d’or. Une beau bordel. Bob Fosse a refusé de monter sur scène, ce qui a exaspéré Kirk Douglas, qui s’est vengé en multipliant les remarques acerbes, sous les vivats de la foule. Un moment très embarrassant. »
22 mai 1981
La Peau
Sept ans après les polémiques qui entourent la sortie du sulfureux Portier de nuit, critiqué pour son « esthétique nazie » et « sa mise en scène malsaine », Liliana Cavani débarque sur la Croisette avec un film qui n’arrange pas sa réputation de « cinéaste maudite ».
La Peau est une adaptation du roman autobiographique de Malaparte, celui de la célèbre villa de Capri immortalisée dans Le Mépris de Godard. Officier italien et dandy provocateur, il raconte son rôle d’intermédiaire avec les Alliés, à Naples, au moment de sa libération par les forces américaines. Son but : montrer le choc de deux cultures. Le livre, publié en 1949, est très mal reçu par les Italiens qui n’apprécient guère le tableau d’abominations et de dégoût que l’écrivain fait de sa ville d’adoption au sortir de la guerre, où tout le monde en prend pour son grade, vainqueurs comme vaincus.
La cinéaste italienne choisit Marcello Mastroianni pour jouer le rôle de Malaparte. Il est sublime et met tout le monde d’accord. Idem pour Burt Lancaster dans le rôle du général Cork. Non, ce qui déplaît au public cannois, ce sont toutes ces atrocités filmées avec un hyper-réalisme qui laisse chacun au bord de la nausée. Et plus encore que les tripes au soleil d’un moribond hurlant sa souffrance, le sang d’une vierge étalé sur le visage de son père ou un fœtus bouilli en guise de plat, c’est la façon dont « Cavani contemple avec mépris ses tristes héros » qui choque certains spectateurs. Avec son final apocalyptique du Vésuve en flammes et l’image d’un corps écrasé par les chars libérateurs, on sort de la projection physiquement et moralement groggy.
Oui, Cavani fait scandale, mais c’est pour mieux exprimer l’infamie engendrée, dit-elle, par « la stupidité des hommes, incapables de voir le bonheur, de raisonner, de cohabiter ». Et elle ajoute : « L’homme n’est doué que pour mettre des barrières et créer des conflits. Tout ça au nom de l’économie et de la paix. »
16 mai 1983
L’Argent
1983. Les projections de Nostalghia (Andreï Tarkovski) et de L’Argent (Robert Bresson) sont abandonnées en route par une partie des festivaliers, qui tempêtent, entre colère et leur ennui. Sièges qui claquent, sifflets… Rien de bien nouveau sous le soleil cannois, finalement ; la routine d’un festival exigeant et d’une sélection pointue, qui ne rencontre pas forcément son public.
Mais le malaise autour des films se prolonge. Les conférences de presse des deux cinéastes, sur la défensive, sont tendues. Des quiproquos de traduction laissent même croire à Tarkovski que Bresson exige une Palme sinon rien, un caprice qui laisse le cinéaste russe pantois, lui qui vénère depuis ses débuts la simplicité et l’humilité du réalisateur français.
La cérémonie de clotûre réunit les deux hommes. Récompensés d’un prix inventé à la hâte par le jury (le Grand prix du cinéma de création), censé couronner à la fois leurs films et l’ensemble de leurs carrières, Robert Bresson et Andreï Tarkovski sont appelés sur scène par Orson Welles. La réunion des trois géants devrait enchanter la salle, mais la réception houleuse des deux films a laissé des traces. Bresson est accueilli sous les huées, et Tarkovski à peine plus chaleureusement. La gêne s’installe, Bresson refuse de dire un mot de remerciement quand Tarkovski, face à l’insistance du maître de cérémonie, se contente d’un las « merci beaucoup ».
Robert Bresson, dont c’était le dernier film, ne reviendra jamais sur la Croisette. La dernière image cannoise du cinéaste, avant qu’il ne retourne dans les pénombres des coulisses, restera celle d’un réalisateur conspué, soutenu par son admirateur de toujours.
13 mai 1986
Max, mon amour
Cannes, 13 mai 1986. Jour de la projection à scandale tant attendue. Enfin le film dont tout le monde parle, celui qui suscite tous les fantasmes et le tollé qui va avec. Max, mon amour ou les relations ambiguës d’une femme et d’un chimpanzé, par Oshima, l’auteur de L’Empire des sens, coécrit par Jean-Claude Carrière, le scénariste de Buñuel, et interprété par Charlotte Rampling, l’actrice du sulfureux Portier de nuit de Cavani.
« Jadis le crapaud amoureux d’une princesse se muait en jeune premier. Ici, le singe demeure singe. Tous les hommes prétendent aimer les animaux. Reste à savoir jusqu’où. » Jean-Claude Carrière attise la curiosité. Jusqu’où sont-ils allés avec Oshima dans la provocation et la transgression du tabou ? Les spectateurs frissonnent d’avance en montant les marches du Palais des festivals.
Mais quelle déception en les redescendant ! Le public s’attendait à tout sauf à ça : Margaret ne couche pas avec le singe. Pire encore, on n’en sait rien. Le voilà le scandale : Oshima est venu sur la Croisette avec un film qui ne fait pas scandale. Pas de scènes osées, ni de détails scabreux, aucun voyeurisme. Le cinéaste japonais livre un vaudeville zoophile pudique, élégant et pince-sans-rire. La mise en scène est rigoureuse et dépouillée. « Avec un sujet aussi singulier, pas question de mise en scène singulière au risque de faire pléonasme et de pervertir le film. »
À l’instar de son héroïne, Oshima cultive le décalage et le mystère : « La liberté d’un cinéaste, c’est de choisir ce qu’il montre et ce qu’il cache. Et de ne pas répondre à une attente programmée ».
14 mai 1987
Sous le soleil de Satan
40e Festival de Cannes, 19 mai 1987. Pour la première fois, la cérémonie de remise des prix est retransmise en direct. Devant les caméras d’Antenne 2, Maurice Pialat vient chercher sa Palme d’or pour son film Sous le soleil de Satan… sous les sifflets.
Retour en arrière. Depuis la projection du film, les critiques se déchaînent. Sous le soleil de Satan n’a pas plu à tout le monde : trop sombre, trop lisse. L’adaptation du roman de Bernanos trop littérale. Les dialogues sont longs, soutenus. Pialat et Toscan du Plantier s’en prennent à leur attaché de presse. Comment a-t-il pu laisser sortir des critiques aussi détestables ? Depardieu intervient et demande à ce que l’on retire le film de la compétition. Pialat et Toscan écrivent à la direction du festival, dénonçant « la pourriture du système, son organisation et ses méthodes ».
Pendant ce temps, ça s’agite aussi en coulisses. Yves Montand, alors président du jury, doit faire preuve de diplomatie lorsqu’Elem Klimov, membre du jury, refuse catégoriquement que la Palme d’or soit remise au film de Nikita Mikhalkov, Les Yeux noirs, grand favori de la sélection. Farouchement opposé à son compatriote soviétique dont il ne partage pas les idées politiques, Klimov déclare violemment : « Si cette ordure, ce salopard de Mikhalkov est récompensé, je me retire du jury et ferai connaître ma décision avec éclat. »
Pour éviter le scandale, le jury décide finalement d’attribuer la récompense à Maurice Pialat. Ce qui déclenche un autre scandale. Sur scène, devant les huées, Pialat jubile. Empochant sa Palme d’or, il fait cette déclaration fracassante devenue culte : « Je ne vais pas faillir à ma réputation, je suis surtout content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m’adressez. Et si vous ne m’aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus ! » En guise de bouquet final, Pialat lève le poing vers la salle, un poing de victoire que certains prendront comme un bras d’honneur.
14 mai 1989
Sexe, mensonges et vidéo
14 mai 1989, Wim Wenders annonce l’une des Palmes d’or les plus inattendues de l’histoire du Festival de Cannes : Sexe, mensonges et vidéo. Trois mots, quatre acteurs, et la récompense suprême pour le premier film d’un jeune réalisateur inconnu de vingt-six ans.
L’histoire de Graham, qui collectionne les enregistrements vidéo de femmes dévoilant les détails de leur vie intime, séduit véritablement la Croisette. Sensuel et cérébral, le film de Soderbergh se détache de la production américaine moyenne. Incontestablement, « un gentil petit film » parfait pour décrocher la Caméra d’or, qui récompense les premières œuvres. Mais « certainement pas une Palme d’or », doublée d’un très contesté Prix d’interprétation masculine pour James Spader. « Une aberration ! » L’acteur, déjà rentré aux États-Unis, n’est même pas là pour recevoir son prix.
Mais le plus surpris de tous, c’est Soderbergh lui-même. Tellement abasourdi, qu’à la fin de la cérémonie, il en oublie son trophée sous le siège. Quoi ? C’est lui le grand vainqueur, face à Imamura, Scola, Kusturica ou le favori Spike Lee ? Le président du jury n’a pas retenu le film de Spike Lee, prétextant qu’il n’y a pas de héros dans Do the Right Thing. Le cinéaste afro-américain, très fâché, demandera à propos du personnage interprété par Spader : « Qu’y a t-il d’héroïque à mater des femmes sur vidéo ? » Et d’ajouter qu’il possède depuis une batte de base-ball avec le nom de Wenders gravé dessus.
26 mai 1995
Underground
1995. Dix ans après Papa est en voyage d’affaires, Emir Kusturica remporte sa deuxième Palme d’or pour Underground. Pendant trois heures douze de grosse fiesta slave, bouffonne et tragique, le film retrace un demi siècle d’histoire de la Yougoslavie, de l’occupation nazie à l’éclatement du pays en 1992. Un vrai choc esthétique et une évidence pour les festivaliers. Mais aussi un sujet explosif qui déclenche la polémique.
Au lendemain de l’annonce du palmarès cannois, Alain Finkielkraut signe une tribune assassine accusant Kusturica de « porter aux nues la version rock, postmoderne, décoiffante, branchée, américanisée, et tournée à Belgrade, de la propagande serbe la plus radoteuse et la plus mensongère ». Suivi de près par Bernard-Henri Lévy qui reproche au cinéaste de faire l’éloge de Milošević dans ses interviews. Ni l’un ni l’autre n’ont vu le film et les réactions ne tardent pas à fuser. « Faut-il brûler Underground ? » Détracteurs et défenseurs s’écharpent.
Par chance, ceux-là n’étaient pas conviés au dîner de clôture du Festival. Loin du conflit idéologique serbo-bosniaque, on improvise une fête sur une plage de la Croisette. L’alcool coule à flot, la musique tzigane résonne, les stars se pointent et s’installent autour du lauréat et de sa bande. Carole Bouquet s’enivre dans sa robe rouge. Gestes déplacés d’un copain serbe un brin lourdingue. Le garde du corps de Johnny Depp s’interpose. Le fils Kusturica s’en mêle, sa mère attrape une chaise en criant. Emir et ses potes interviennent. Coups de boules et baston générale à la mode des Balkans. Le cinéaste en assomme un et s’affole : « Mon dieu, dans la même soirée, je gagne la Palme d’or et je tue quelqu’un ! » Johnny Depp se cache sous la table avec les enfants. Jim Jarmusch, perplexe, contemple la scène. L’acteur Miki Manojlović s’empare de la Palme et la cache sous son smoking. Imperturbable, l’orchestre tzigane continue à jouer. Pour Kusturica, « cette nuit triomphale n’aurait pas été réussie si la catharsis contagieuse d’Underground ne s’était pas incarnée dans la vie ».
17 mai 1996
Crash
C’est un Prix du jury très spécial que reçoit David Cronenberg cette année-là. Sur la scène du palais des festivals, pendant la remise du prix, le président du jury, Francis Ford Coppola, a l’air embarrassé. Crash n’a pas fait l’unanimité, il tient à le préciser. Le film est récompensé, mais avant tout « pour son audace et son originalité ».
Il faut dire que Crash n’est pas un film ordinaire. Cronenberg le sait bien, et même pour sa première sélection cannoise, il n’est pas question de respecter les conventions du cinéma hollywoodien. Le maître de l’obsession traumatique avoue même qu’en adaptant le roman de J. G. Ballard, il réalise un film choc en poussant ses fantasmes très loin. Le livre avait déjà suscité des réactions à sa parution en 1973, amenant un éditeur à signaler : « Cet auteur a besoin d’une aide psychiatrique. Ne pas publier. »
C’est une histoire d’orgasmes automobiles. Eros et Thanatos montent en voiture et le public assiste aux expériences perverses d’un groupe d’adeptes de la jouissance par les blessures et les mutilations provoquées par des accidents de voitures. « Film racoleur, malsain, porno », entend-on dans les travées du Festival, qui tient là sa polémique. Même ceux qui aiment le film ne sont pas sûrs des raisons pour lesquelles ils l’aiment. La plaisanterie préférée de la Croisette : « Avez-vous votre permis de conduire ? » Cronenberg plaide coupable. « Je comprends les spectateurs qui sifflent. Le film est fait pour provoquer. Et je ne pouvais rêver meilleure publicité que cette controverse pour faire exister une œuvre si singulière. »
14 mai 1997
Funny Games
« Dans un thriller classique, les enfants et les animaux sont en général épargnés. Dans Funny Games, c’est d’abord le chien qui meurt. Puis l’enfant. » En 1997, l’Autrichien Michael Haneke terrorise la Croisette avec son film, d’une violence telle qu’il mène certains spectateurs au bord de l’évanouissement.
Deux ados psychopathes séquestrent une famille de bourgeois dans leur maison de vacances. Humiliations, torture, meurtres. Les scènes sont froides et brutales, faites pour « agresser le public ». Trois ans après sa « trilogie de la glaciation émotionnelle » (Le Septième continent, Benny’s Video et 71 fragments d’une chronologie du hasard), interdits en France au moins de 16 ans, Haneke monte volontairement le curseur du malaise et du dégoût un cran plus haut. Son modèle : Salò ou les 120 journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini, qui l’a profondément marqué : « Après l’avoir vu, j’ai été choqué. Malade pendant deux semaines. Ça m’a bouleversé. Et c’est à partir de là que j’ai compris ce qu’était vraiment la violence, la souffrance physique et mentale. Naturellement, cela m’a donné envie d’arriver à provoquer cette même décharge. »
Le film commence donc comme un thriller, mais quand l’agresseur s’adresse à la caméra pour la première fois, il viole les codes du genre. Pris en otage, les spectateurs deviennent les complices passifs du massacre annoncé. Les plus horrifiés quittent la salle. Ceux qui restent croient à un relatif happy end lorsque la mère parvient à abattre l’un des deux tueurs. Soulagement. Le public applaudit. Mais c’est compter sans le manipulateur Haneke, qui rembobine aussitôt le film. Le bourreau ne meurt pas et le calvaire se poursuit. Colère des spectateurs qui ne voient dans Funny Games qu’une apologie de la violence. Le cinéaste s’explique : « Mon film est comme un coup dans l’estomac parce que je pense que le spectateur n’est pas prêt à se rendre compte de son rôle de voyeur. De temps en temps, nous avons besoin d’une bonne gifle pour nous réveiller, car nous perdons le lien avec la réalité de la violence. Certains films américains très violents peuvent être consommables, dans le sens “avoir du plaisir à voir ça”. Avec Funny Games, je voulais parler de la violence sérieusement. »
Et pour que les spectateurs américains reçoivent bien le message, Haneke enfonce le clou, dix ans plus tard, avec un remake de son propre film : Funny Games US.
16 mai 1997
Le Goût de la cerise
Lorsqu’un journaliste lui demande s’il a eu des problèmes pour venir à Cannes, Abbas Kiarostami répond : « Je suis arrivé un peu en retard, mais j’y suis. » Le dernier film du cinéaste iranien figure dans la sélection officielle, mais a bien failli ne pas y être. Au départ, les autorités iraniennes trouvent Le Goût de la cerise suspect, l’œuvre n’ayant pas été présentée au Festival de Téhéran (passage obligé avant toute diffusion à l’étranger). Et puis le sujet du film n’est pas franchement conforme à la « morale islamique ». L’histoire de cet homme dont l’ultime liberté est de se suicider ne passe pas la censure. Le film reste bloqué jusqu’à ce que le ministère iranien des Affaires étrangères intervienne, finalement, en faveur du cinéaste, juste après l’ouverture du festival, jugeant qu’il serait fâcheux de voir l’Iran donner un exemple de censure de façon aussi officielle.
Le Goût de la cerise est projeté le 16 mai. Deux jours plus tard, après de longues délibérations et quelques dissensions entre Nanni Moretti et la présidente Isabelle Adjani, le film reçoit la Palme d’or, ex-aequo avec le film d’Imamura, L’Anguille. Le palmarès est critiqué. On lui reproche de couper la Palme en deux, ce qui affaiblit sa portée. Qui plus est, elle semble couronner davantage les cinéastes que leur dernier film.
Cependant, Kiarostami a d’autres inquiétudes : « Je suis évidemment content de recevoir le prix, mais l’idée de le rapporter en Iran rend ma situation difficile. » Entre une période de deuil religieux national et des élections au moment de son retour, aucun média iranien ne fera mention de cette Palme. Et c’est très bien ainsi. Excepté quelques amis venus l’accueillir à l’aéroport avec joie et émotion, les seules réactions concernant le festival seront provoquées par le baiser que lui donne Catherine Deneuve en lui remettant la Palme d’or. « Comme il n’a été question ni du film ni du festival, de nombreux Iraniens se demandent pourquoi je suis allé en France uniquement pour embrasser une femme devant les caméras ! »
20 mai 1998
Khroustaliov, ma voiture !
« À mon avis, tous ces intellectuels de gauche européens n’ont jamais rien compris à ce qui se passait chez nous. » Le Russe Alexeï Guerman est amer. Son dernier film, Khroustaliov, ma voiture !, présenté à Cannes cette année-là, fait figure de grand oublié du palmarès. On parle pourtant de chef-d’œuvre. Comme ses précédents films, quatre en 29 ans, une œuvre puissante, toujours en noir et blanc et dédiée à l’histoire de son pays.
Khroustaliov, ma voiture ! n’a rencontré que du mépris de la part des festivaliers. Dans ce tableau cauchemardesque des dernières heures du stalinisme, les torrents d’images, où scènes de violence succèdent aux scènes de folie, plongent le spectateur dans un état de stupeur. Trop de paroles, de personnages, de bruits. Les spectateurs ont le tournis. Un film effrayant, difficile à suivre, hors normes, que le cinéaste russe a mis près de dix ans à sortir, entre censures successives et tournage chaotique. « J’ai refusé de tourner avec de la pellicule française : elle embellit tout. Notre réalité doit être filmée avec notre pellicule ! » Car Guerman veut aussi rendre compte de ce qu’il appelle « l’insupportable douleur d’être russe ».
Douloureuse aussi, cette reconnaissance qui peine à venir. « À 60 ans, je connais ma place. Et je sais que l’accueil que j’ai reçu à Cannes est profondément injuste. En France, tout le monde dit admirer Tarkovski. Mais à l’époque où vous avez vu ses premiers films, tout le monde lui crachait dessus. Le problème de l’échec à Cannes, c’est que maintenant, plus personne ne veut acheter le film pour le distribuer en Russie, parce que je n’ai pas eu de prix. Cannes a encore fragilisé ma position économique. »
À sa mort en 2013, les critiques sont unanimes. Alexeï Guerman est classé parmi les plus grands cinéastes russes contemporains.
22 mai 1999
Rosetta et L’Humanité
À Cannes, on peut polémiquer parce que le jury récompense « un film à Palme ». Ou au contraire parce que ce n’est pas « un film à Palme ». En 1999, alors que les paris se jouent entre Lynch, Almodóvar, Kitano ou Jarmusch, la Palme d’or est finalement attribuée, à l’unanimité, aux frères Dardenne (beaucoup moins connus que les frères Coen) pour Rosetta. Et ça dérange. D’autant plus que le Grand prix revient à Bruno Dumont pour son peu aimable Humanité, et les prix d’interprétation remis à trois illustres inconnus. Émilie Dequenne, qui joue Rosetta, Séverine Caneele et Emmanuel Schotté, héros de L’Humanité, viennent chercher leurs prix sous les huées.
Il faut dire que la remise de la Palme d’or avait mal commencé. Une certaine agitation se fait sentir dans l’assemblée lorsque Sophie Marceau, chargée de remettre le prix, se lance dans un discours plus que lunaire qui déclenche rires et sifflets. L’annonce de la Palme d’or fait ensuite l’effet d’une bombe. L’information relayée les jours suivants dans la presse est des plus violentes.
Portrait âpre d’une jeune chômeuse à la recherche d’un travail et d’une vie normale, Rosetta est taxé de misérabilisme. Quant à L’Humanité, le film suscite des ricanements, du dégoût et de l’ennui avec son histoire d’enquête sur un viol de fillette menée par un flic neurasthénique et obsédé sexuellement par sa voisine. Certains ne voient aucune valeur artistique dans ces deux films « ultradocumentaires ». Les mêmes contestent l’attribution du prix à des acteurs « non professionnels » en prétextant une absence totale de jeu. On reproche au Festival de mettre en avant « des personnes moches ». Cronenberg est accusé d’être un président du jury irresponsable, mettant l’industrie du cinéma en péril. Rarement un palmarès n’avait produit autant d’agressivité, la Palme de l’insulte revenant au réalisateur Pascal Thomas : « Le couronnement de Rosetta, que je n’ai pas vu, s’inscrit parfaitement dans la ligne du dernier Festival de Cannes, avec son palmarès de gâteux organisé par un président gâteux qui court après la modernité, où tout est conçu non pour encourager le bon cinéma, mais pour fabriquer une image et attirer l’attention, et où on décerne des prix d’interprétation à des débiles mentaux, à des abrutis, qui ne savent pas jouer la comédie et qui mériteraient plutôt le Grand prix du grotesque. »
Prix mérités ou pas, les Dardenne et Dumont ont gagné, cette année-là, la promesse d’un retour assuré au Festival de Cannes.
23 mai 2002
Irréversible
23 mai 2002, minuit et quelques. Séance tardive interdite aux moins de 16 ans. Les sapeurs-pompiers de Cannes sont débordés. Dans le hall du palais, ils récupèrent les spectateurs pris de malaises ou au bord de la crise de nerf. Ceux qui ont repris leur souffle descendent les marches. Un journaliste muni d’une caméra espère recueillir leurs réactions.
Il y a ceux, muets, incapables d’émettre un son, qui courent vers la sortie, au bord de la nausée. Il y a ceux, furieux, qui laissent éclater leur colère : « C’est scandaleux ! C’est lamentable de faire des choses pareilles ! » « Horrible ! » « C’est dégueulasse ! » Et il y a les curieux pour qui les films à scandales sont un spectacle assuré : « Moi ce qui m’intéressait – ça fait la deuxième fois que je le vois – c’était la réaction de la salle. » Séance gagnante, les spectateurs crient et sortent par paquets dès les premières vingt minutes de film.
Interprété par le couple le plus glamour du moment, Monica Bellucci et Vincent Cassel, Irréversible fait l’objet, depuis le début, d’un battage médiatique et commercial fondé sur la perspective d’un scandale. À fond dans la provocation, Gaspar Noé place le spectateur dans une position de voyeur le rendant complice des scènes d’une violence crue et sans limite. Tout commence par la fin de l’histoire : une vengeance avec crâne défoncé à coups d’extincteur. Le film remonte le cours du temps. Puis vient la scène la plus choquante, celle du viol de Monica Bellucci, plan-séquence de dix minutes insoutenables. Détourner le regard ou sortir de la salle ? Cette nuit-là, à Cannes, deux cents personnes ont préféré rentrer à l’hôtel.
21 mai 2003
The Brown Bunny
Ceci est bien une pipe. Le scandale, cette année-là, une fellation non simulée entre Chloë Sevigny et Vincent Gallo. La scène se passe dans les dernières minutes de The Brown Bunny, deuxième long métrage de Gallo (après le très apprécié Buffalo ’66). Les spectateurs n’y voient qu’une provocation, le climax éclipsant la vacuité d’une œuvre radicale jugée soporifique, irritante, interminable.
Si le débat fait rage sur la Croisette – Gallo a-t-il utilisé une prothèse pour simuler l’acte sexuel ? –, son film n’en reste pas moins un fiasco total. The Brown Bunny est taxé de pire film de l’histoire de Cannes, réalisé et interprété par un type narcissique et prétentieux, capable de traiter de connards tous ceux qui pensent que son pénis est un postiche. Gallo n’a pas la réputation d’être poli et répond aux attaques du critique Roger Ebert sans ménagement : « Il n’est qu’un gros porc avec le physique d’un marchand d’esclaves ». Ce à quoi Ebert réplique qu’il pourra maigrir, mais que Gallo sera toujours le réalisateur de The Brown Bunny. Et quand il lui souhaite un cancer du côlon, le critique le mouche encore, lui faisant remarquer que sa coloscopie est bien plus divertissante que son film. Ambiance. De son côté, Chloë Sevigny, icône et égérie incontournable du cinéma indépendant, en fait également les frais. La fameuse scène subversive lui vaut de se faire lâcher par ses agents.
Face à ce désastre, Gallo consent à revoir sa copie. Il remonte son film, l’écourte d’une demi-heure, et fait, par la même occasion, la paix avec Ebert : « On dit que le montage est l’âme du cinéma. Dans le cas de The Brown Bunny, c’est son salut ! »
17 mai 2004
Fahrenheit 9/11
Plus de 2 000 spectateurs debout. Ovation de 20 minutes. Du jamais-vu sur la Croisette. La première projection cannoise du film de Michael Moore annonce la couleur. Public conquis, Quentin Tarantino et ses jurés le sont aussi. Ce sera la Palme d’or pour Fahrenheit 9/11.
Pour autant, certains font la grimace. Qu’est-ce que vient faire ce brûlot anti-Bush parmi les Palmes d’or ? Le jury a beau répéter avoir récompensé une œuvre artistique, la presse n’y voit qu’un geste politique inapproprié dans le plus grand festival de cinéma du monde. Mais où est le mal à récompenser un pamphlet ? La polémique enfle d’autant plus qu’il se trouve que Moore et Tarantino partagent les mêmes producteurs, les frères Weinstein de Miramax. Certes, mais le président du jury n’a pas été le seul à décider. Alors que reproche t-on vraiment à Fahrenheit 9/11 ?
Révélations spectaculaires, archives télévisées montées à la sauce Moore, commentaires sarcastiques… On accuse le film de simplisme et de démagogie. Les méthodes du cinéaste engagé agacent. On n’aime pas son côté moralisateur et donneur de leçon, ni sa façon de se mettre trop en avant. Il s’en défend : « Honnêtement, pensez-vous qu’avec le physique que j’ai, je m’exhibe par plaisir ? Non, je déteste ça. Mais j’ai réalisé que je suis devenu la doublure des anonymes qui n’ont pas de tribune d’expression ou les moyens de poser des questions dérangeantes. Alors, à chaque fois que je rue dans les brancards, je le fais pour eux. » Car ce que Moore souhaite avant tout, c’est faire passer son message au plus grand nombre.
C’est chose faite. Cette Palme d’or lui permet de trouver un distributeur aux États-Unis, avec la garantie d’être vu du public américain, celui « des vendredis soir et du pop-corn », habitué aux émissions de « propagande » télévisées.
22 mai 2008
La Frontière de l’aube
Libération du 23 mai 2008. Philippe Azoury et Olivier Séguret sont très énervés : « Ah ! Si ce soleil avait aussi pu cramer dans son feu d’enfer les douze trous du cul qui ont tenté de pourrir la projection de leurs ricanements ringards. » La controverse qui éclate sur la Croisette cette année-là est provoquée par le film de Philippe Garrel, héritier « rock » de la Nouvelle Vague. Première sélection du cinéaste à Cannes, La Frontière de l’aube déclenche rires et sifflets dès la première projection matinale. Mais que reproche t-on au juste à cette histoire d’amour fou entre une star de ciné fragile et un photographe ?
La Frontière de l’aube, aux allures de film fantastique, est perçu par ses détracteurs comme plat, premier degré, ridicule. Au contraire, pour Azoury et Séguret, avec son noir et blanc somptueux et sépulcral, il rappelle les plus beaux films de vampire des années 20. « Devant des apparitions qui évoquent l’innocence d’un Murnau, ces cons finis riaient. » Si la présence chimique de Laura Smet, qui irradie le film en font chavirer plus d’un, d’autres, comme Eric Neuhoff au Figaro, n’y voient qu’une « revenante boudeuse et croquignolette, entre Blanche-Neige et Poltergeist ». Louis Garrel n’est pas épargné : « Il serait urgent de lui expliquer qu’on ne peut pas être à la fois Fernandel et Guy Debord ».
La séance du lendemain est un désastre : la salle est à moitié vide. Préférant se fier aux rumeurs, les festivaliers condamnent aussitôt le film avant même de l’avoir vu. « Laissons de côté les grincheux, les râleurs, les insensibles. Car le dernier film de Philippe Garrel est d’une telle perfection plastique, d’une beauté si saisissante et met en scène des acteurs si incroyables qu’on voudrait jeter aux lions tous ceux qui n’ont pas voulu se laisser porter par cette histoire. » Avec La Frontière de l’aube, on n’avait pas vu un tel affrontement depuis La Maman et la putain d’Eustache en 1973 et L’Avventura d’Antonioni en 1960, deux autres films aux personnages féminins forts et sublimes.
21 mai 2009
Hors-la-loi
Une fois n’est pas coutume, c’est devant un cordon de CRS et de gendarmes que l’équipe du film de Rachid Bouchareb monte les marches du Palais des festivals. Un peu plus fouillés que d’habitude, journalistes et festivaliers se rendent à la projection de Hors-la-loi.
À quelques centaines de mètres de là, devant le monument aux morts de la mairie, une autre foule se réunit : harkis, pieds-noirs, élus locaux et militants Front National, bien décidés à protester contre ce « film sordide, caricatural, partisan et pro-FLN ». Depuis plusieurs mois, sur une simple lecture du scénario et bien avant même d’avoir vu Hors-la-loi, le député des Alpes-Maritimes Lionnel Luca accuse Bouchareb d’avoir « falsifié l’histoire » et conteste la façon dont il rend compte du massacre de Sétif, épisode peu connu de l’histoire française, perpétré le 8 mai 1945. En réaction à des manifestations pro-indépendantistes dans l’Est algérien, une centaine d’Européens et plus d’un millier d’Algériens avaient trouvé la mort.
Sur les pancartes des manifestants cannois : « Hors-la-loi : Palme du mensonge », « Les cris des pieds-noirs coupés au montage ». Salut aux couleurs, le Chant des Africains et La Marseillaise résonnent. Thierry Frémaux, délégué général du Festival, tente de dissiper les tensions : « Je sais bien que Cannes est une telle chambre d’écho, que la tentation est grande de l’instrumentaliser pour s’y faire entendre, mais il est temps d’apaiser les discussions et d’attendre, pour les reprendre, que les films incriminés soient vus. »
C’est chose faite et le public qui sort de la projection ce vendredi 21 mai ne semble pas scandalisé outre mesure : « Évidemment le film va raviver d’anciennes haines, et la liberté qu’il prend avec l’Histoire sera très mal vécue par les milieux de rapatriés. » Mais en définitive « tout le battage qu’il y a autour de cette polémique paraît bien inutile ». Qui plus est, la scène incriminée ne dure que six minutes sur les deux heures dix-huit.
18 mai 2009
Antichrist
« Chaos reigns ». Prononcée par un renard en sang, cette retentissante ligne de dialogue résume aussi bien Antichrist que son orageuse réception cannoise, entre huées, rires nerveux, claquements de fauteuils et clameurs énamourées. Le film de Lars Von Trier, ultraviolent, laisse la Croisette hébétée, dans cet état de sidération rare, propre aux vrais scandales qui ont émaillé l’histoire du Festival.
La conférence de presse qui suit sert d’exutoire. « Franchement, j’ai eu l’impression d’avoir la tête dans les latrines pendant deux heures. Je vous somme de vous justifier ». Pourtant habitué aux confrontations électriques, Lars Von Trier est cueilli à froid par le réquisitoire de Baz Bamigboye (Daily Mail), auquel il refuse de répondre. Il se défendra plus tard : « Je peux comprendre la rage des journalistes, mais me justifier, c’est insupportable. Quand je montre un film, je me mets à nu, et c’est déjà assez violent comme ça. Une sélection cannoise, c’est ma fête, les journalistes sont mes invités, et là j’ai eu l’impression contraire, d’être convié à une fête de journalistes. » Le lendemain, la presse se lâche, et fait effectivement sa fête au film. « Abject, dégueulasse, immature, imbécile… ». La curée. Le film n’a que de rares défenseurs, au premier rang desquels – la rumeur est insistante – Isabelle Huppert, présidente du jury à poigne qui n’arrivera toutefois pas à imposer le film au palmarès.
Huit ans après sa sortie, le film alimente toujours la polémique : son interdiction est passée des moins de 16 aux moins de 18 ans après l’action en justice de l’association ultra-catholique Promouvoir…